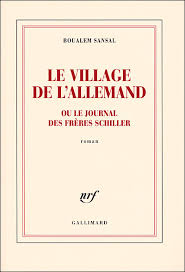Deux frères germano-algéro-français, après l'assassinat de leurs parents par un groupe armé islamiste, découvrent le passé nazi de leur père.
Films, Musiques & Livres
Roman
Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller / Boualem Sansal
Editions Gallimard, 2008
" Les narrateurs sont deux frères nés de mère algérienne et de père allemand. Ils ont été élevés par un vieil oncle immigré dans une cité de la banlieue parisienne, tandis que leurs parents restaient dans leur village d'Aïn Deb, près de Sétif. En 1994, le GIA massacre une partie de la population du bourg. Pour les deux fils, le deuil va se doubler d'une douleur bien plus atroce : la révélation de ce que fut leur père, cet Allemand qui jouissait du titre prestigieux de moudjahid...
Basé sur une histoire authentique, le roman propose une réflexion véhémente et profonde, nourrie par la pensée de Primo Levi. Il relie trois épisodes à la fois dissemblables et proches : la Shoah, vue à travers le regard d'un jeune Arabe qui découvre avec horreur la réalité de l'extermination de masse ; la sale guerre des années 1990 en Algérie ; la situation des banlieues françaises, et en particulier la vie des Algériens qui s'y trouvent depuis deux générations dans un abandon croissant de la République. «À ce train, dit un personnage, parce que nos parents sont trop pieux et nos gamins trop naïfs, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. Vous devrez alors lui faire la guerre si vous voulez seulement la contenir dans ses frontières actuelles.» Sur un sujet aussi délicat, Sansal parvient à faire entendre une voix d'une sincérité bouleversante."présentation de l'éditeur
Extraits choisis :
Le pays vrai est celui où sont enterrés nos parents. Je le ressens comme ça, c'est pourquoi je me sens dans la nécessité d'aller voir cette terre, de marcher sur elle, de prendre un peu de son âmequ'elle tient de toutes les âmes qui l'ont nourrieau cours des siècles. Un secret enveloppé de mystère à l'intérieur d'une énigme, disait un nommé Churchill, que Rachel considérait comme le grand héros de la guerrecontre les nazis. Ça doit être ça, un pays, un mystère.
Articles de presse :
Avec ce cinquième ouvrage, Boualem Sansal reprend les armes et s'en va combattre sur tous les fronts - lâcheté, obscurantisme, négationnisme. Il croise le fer avec deux très sales guerres, celle de 1939, celle de l'Algérie des années 90, et il le fait en romancier, en imaginant deux personnages, deux frères qui se connaissent si peu, se parlent si peu. Ils sont nés en Algérie, mère algérienne, père allemand, et ont été confiés à un oncle en France, avec dans leur valise d'immigrés l'espoir d'une vie meilleure. Ils s'enracinent dans une banlieue parisienne sans rien connaître de leur langue, de leur famille, de leur histoire... L'aîné, Rachel, joue l'intégration : études supérieures, poste de cadre dans une multinationale, jolie femme et pavillon idem. Le cadet, Malrich, tout juste 17 ans, est un gamin de la cité. Il vit au jour le jour, sans se poser de question, ni sur le lendemain, ni sur le passé. Le Village de l'Allemand s'ouvre sur le suicide de Rachel. Malrich découvre le journal intime de son frère et l'enfer lui tombe dessus. Il se met lui aussi à écrire, à sonder l'insondable.
Rachel a appris que leurs parents ont été massacrés par le GIA. C'était en 1994, à Aïn Deb, près de Sétif. Il s'interroge sur le silence qui entoure leur mort, pousse l'enquête, et piste une autre horreur : son père, si respecté au « bled », est un ancien nazi, un SS qui a oeuvré dans les camps de la mort. Rachel sombre : « Hans Schiller, tu es une crapule, le pire des assassins, je te vomis, je te hais [...]. Tu n'avais pas le droit de vivre, tu n'avais pas le droit de nous donner la vie, cette vie, je n'en veux pas, elle est un cauchemar, une honte indélébile. Tu n'avais pas le droit de fuir, papa. Je dois assumer à ta place, je vais payer pour toi, papa. » Est-on coupable des crimes de ses parents ? Est-on coupable de ne rien savoir, de ne pas connaître l'Histoire, de tout ignorer des génocides, des guerres ? Qui doit transmettre et comment ? Malrich, comme son frère avant lui, cherche à comprendre. Ignorant de tant de choses, il bute, fonctionne à l'intuition et s'en prend à Primo Levi : « Il est fou, ce Primo Levi. Je refuse de croire que Dieu est plus vicieux que les hommes et que les enfants sont condamnés à la fatalité. » Au désespoir profond de Rachel se cogne la révolte de Malrich. L'aîné use d'une écriture réfléchie. La prose du cadet éclate d'impertinence, de drôlerie. Boualem Sansal met en scène la colère, la honte. Il dénonce sans haine mais à mots clairs les fanatiques en tous genres, religieux, politiques ; il énonce toutes les abominations dont sont capables les hommes si peu humains. Sansal met sur le papier ses frayeurs, et va, serein, de la gravité à la tendresse. Un vrai tour de force.
L'Algérie à vif
De la Seconde Guerre mondiale à l'Afrique du Nord: dans son nouveau roman, Boualem Sansal confronte deux frères issus d'un mariage mixte à l'histoire et à l'horreur. Vous avez dit engagé"
Surtout, ne pas se fier à son air juvénile et doux, à son allure d'étudiant décontracté; ne pas se fier à sa voix posée, à son sourire serein, à son regard tendre: Boualem Sansal a la rage. Il ne la crie pas, il l'écrit. Ou plutôt il la crie par écrit. Depuis son premier roman, Le serment des barbares, paru en 1999, cet écrivain algérien de 59 ans dénonce avec une extrême virulence la faillite de son pays. Avec une extraordinaire éloquence, il fustige dans un même élan militaires et islamistes, dénonce cette Algérie minée par «le traficotage, la religion, la bureaucratie, la culture du crime, du coup, du clan, l'apologie de la mort, la glorification du tyran, l'amour du clinquant, la passion du discours hurlé» - comme il le fait si bien dire à Lamia, l'héroïne d'Harraga, son quatrième roman paru en 2005. De livre en livre, dans un français éblouissant, sans haine mais avec une alacrité réjouissante, Boualem Sansal enfonce le clou, invective, vitupère, remet inlassablement la plume là où ça fait mal. Après deux essais, le cinglant Poste restante: Alger. Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes (Gallimard, 2006) et Petit éloge de la mémoire (Folio, 2007) qui retrace quatre mille ans d'histoire de l'Algérie, il revient à la fiction avec Le village de l'Allemand. Sous-titré Le journal des frères Schiller, ce roman sidérant relie les horreurs de la Seconde Guerre mondiale à celles de l'Algérie des années 1990. Deux sales guerres qui font le lien entre nazisme et islamisme. Un parallèle osé pour mieux stigmatiser le négationnisme et les ravages de tous les fanatismes.
Mère algérienne, père allemand, les frères Schiller sont nés en Algérie mais ont grandi en France, chez leur oncle, sans rien connaître de leurs origines, de leur histoire. L'aîné, Rachel (contraction de Rachid et Helmut), a fait un parcours sans faute pour devenir cadre dans une multinationale, épouser une jolie femme et acheter son pavillon. Le cadet Malrich (contraction de Malek et Ulrich), 17 ans, a pris la mauvaise pente et traîne avec les sinistrés de la cité. Le roman s'ouvre sur le suicide de Rachel, le 24 avril 1996. En lisant le journal intime de son frère, Malrich découvre les raisons de ce geste désespéré: de retour au village natal pour se recueillir sur la tombe de ses parents, massacrés par le GIA (Groupe islamiste armé) le 24 avril 1994, Rachel a découvert que leur père, Hans Schiller, était un ancien nazi. Lui qui fut naturalisé algérien, qui s'était converti à l'islam en s'établissant près de Sétif, dans le village de Aïn Deb dont il était devenu le chef respecté, ce père admirable avait oeuvré dans les camps de la mort... A son tour, Malrich a «honte de vivre». Mais il va chercher à comprendre et reprendre le flambeau trop tôt éteint de Rachel pour éclairer cette histoire familiale et nationale pleine d'ombres macabres.
Parti unique, propagande, embrigadement
Au journal de Rachel, sérieux et accablé, répond celui de Malrich, gouailleur et révolté. Une construction narrative originale conjuguée à une l'alternance des tons qui permet de dire le pire. Le sujet est brûlant, l'ensemble n'est jamais scabreux. Comme à son habitude, l'auteur de L'enfant fou de l'arbre creux s'est inspiré d'une histoire vraie: «Ce village existe vraiment», explique-t-il, de passage à Paris le mois dernier. «Je l'ai découvert par hasard, au début des années 1980, lors d'un déplacement professionnel: un village très charmant, très propre, contrastant avec les localités poussiéreuses de la région. J'ai vite appris que c'était le fait de l'Allemand qui le "gouvernait", un ancien officier SS devenu moudjahid et considéré comme un héros.» C'est justement le sujet tabou que Boualem Sansal fait voler en éclats dans son roman: on ne parle pas de l'Holocauste en Algérie. «Faites un sondage à Alger: vous ne trouverez pas plus de dix personnes au courant de la Shoah. Et encore, la plupart répéteront que c'est une invention des juifs. Il n'y a jamais eu de film, de livre, de conférence sur le sujet. Aucun programme scolaire n'en fait état.» Mais le romancier ne va-t-il pas trop loin lorsqu'il fait le parallèle entre l'Algérie d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie? «Non, ceux qui ont conduit l'Algérie à la guerre civile ont eu recours aux mêmes méthodes que les nazis: parti unique, militarisation du pays, propagande à outrance, omniprésence de la police, délation, falsification de l'histoire, xénophobie, affirmation d'un complot ourdi par Israël et les Etats-Unis, etc. Dans les banlieues françaises, les islamistes imposent une façon de vivre et procèdent à un embrigadement qui fait penser aux camps de concentration.»On comprend que Boualem Sansal soit persona non grata dans son pays, qu'il refuse pourtant de quitter, même après avoir été limogé de son poste de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, en 2003, suite à la sortie de son troisième roman, Dis-moi le paradis. Les choses ne se sont pas arrangées et Poste restante: Alger a été censuré. «Au début ça fait très mal. Après, on se dit que c'est mieux ainsi, les choses sont bien tranchées. Mais je ne fais qu'écrire ce que nous nous disons avec mes compatriotes depuis quarante ans.» C'est donc par nécessité - le besoin de coucher noir sur blanc ce désespoir partagé après les espoirs nés de l'Indépendance - que l'ex-ingénieur est devenu écrivain.
Né le 15 octobre 1949 à Teniet-el-Haad, dans l'ancien département d'Orléansville, deuxième enfant d'une fratrie de quatre garçons et orphelin de père très jeune, Boualem Sansal a hérité de son grand-père chef de gare, qui a fait la guerre de 14-18, un fort attachement à la culture française. Boulimique de lectures, le garçon suivra toutefois une formation technique, la nouvelle Algérie réclamant plus de bâtisseurs que de beaux parleurs. Il se contentera de rédiger des ouvrages très spécialisés, dont un sur les turboréacteurs... Rien à voir avec la vraie littérature de son ami, le romancier Rachid Mimouni, dont Boualem Sansal est le premier lecteur. Mais la terreur islamiste qui s'abat sur le pays à partir de 1991 et la décennie noire qui s'en suit contraignent Mimouni à s'exiler au Maroc, tandis que Sansal reste cloîtré dans son appartement de Boumerdès, non loin d'Alger. «Après 17 heures, il n'y avait plus personne dans les rues, à part les militaires et les terroristes. On ne vivait plus, on ne sortait plus, je me suis mis à écrire.» Il poste le manuscrit du Serment des barbares à l'adresse de Gallimard. L'éditeur Jean-Marie Laclavetine s'enthousiasme aussitôt: «J'ai tout de suite aimé son ton emporté, féroce, sarcastique», se souvient-il. «Boualem Sansal sent bien qu'il n'a pas d'autre issue que d'écrire. Il le fait avec un courage paisible qui inquiète ses amis mais qui force également le respect. Contrairement à ce que font croire ses détracteurs, il est profondément attaché à son pays. Avec Le village de l'Allemand, il n'est pas dans la provocation mais dans le désir de dire une vérité que personne ne veut entendre en Algérie.» L'Occident fait aussi la sourde oreille, déplore Boualem Sansal, qui en appelle à une prise de conscience urgente de la mainmise de l'islamisme sur le monde. Cet écrivain-là n'a décidément pas peur des mots, même s'il doute de plus en plus de leur pouvoir...
Delphine Pera, L'EXPRESS, mars 2008
A l'origine, il y a deux prénoms valises. Rachel (pour Rachid-Helmut) et Malrich (pour Malek-Ulrich), deux frères nés de l'union d'une Algérienne et d'un Allemand, Hans Schiller, dans un hameau du côté de Sétif. C'est là que le couple est massacré avec d'autres villageois, en 1994, lors d'un égorgement collectif pratiqué par un groupe armé islamiste. Les deux fils vivaient en France, au nom de la promotion sociale. L'aîné, Rachel, la trentaine, se rend sur la tombe de ses parents et découvre, dans la maison familiale désolée, une «petite valise pelée» contenant les archives paternelles, c'est-à-dire son livret militaire, ses médailles et tout le saint-frusquin national-socialiste. Hans Schiller se révèle avoir été un gradé nazi, ayant fui après 1945, via la Turquie et l'Égypte, la responsabilité de ses crimes à l'encontre des juifs d'Europe, pour se fondre dans «la guerre de libération» algérienne. Auréolé par sa condition de moudjahid, il avait épousé la fille du cheikh du village et, héritant de ce titre à la mort de son beau-père, avait fait merveille grâce à son sens de l'organisation. Une intégration parfaitement réussie, en somme, qui n'était pourtant qu'un odieux camouflage.
Rachel lui-même, employé modèle d'une multinationale, propriétaire d'un pavillon enviable, époux de la belle Ophélie nantie d'une maman lepéniste, donne tous les gages d'une assimilation plaquée or. Mais la petite valise lourde de secrets qu'il rapporte en France sera son cercueil. Il s'abîme dans l'horreur hitlérienne, calque ses pas sur ceux de son père, pour finalement suivre la voie que celui-ci aurait peut-être dû emprunter: mort de honte, il se suicide au gaz d'échappement.
Durant ses épreuves, Rachel avait tenu son journal. Ce texte a été remis à son puîné de quatorze ans, Malrich, qui se met à son tour à écrire. Le roman diariste de Boualem Sansal est donc constitué des croisements et des emboîtements des journaux de ces deux jeunes Algéro-Allemands naturalisés Français. Le premier, éduqué, fin, tiraillé, s'avère ravagé par un passé devenu bombe à fragmentations au plus profond de lui-même; le second, rudimentaire, titi de la cité, se révèle capable de saisir au bond ce passé pour en faire une arme de combat, qu'il retourne contre les islamistes grenouillant dans sa banlieue et qu'il identifie à des SS en marche. Deux natures, aussi divergentes qu'intimement liées, entament donc un dialogue crucial mais posthume, haletant, qui mêle le désespoir et l'humour, l'abattement et l'énergie.
Boualem Sansal, d'un strict point de vue narratif, offre une prouesse stylistique impressionnante, qui saisit le lecteur au collet et le ballotte entre le pessimisme réfléchi de Rachel, qui s'immole, et la prise de conscience déstructurée de Malrich, qui se bat.
Celui-ci ne fait donc pas dans la dentelle et ignore, souvent au-delà du supportable, que comparaison n'est pas raison, surtout à propos de cet événement unique dans les annales: la destruction des juifs d'Europe. Malrich, qui travailla comme mécanicien, se sert de la Shoah comme d'un outil pratique et à portée de main pour désosser la nébuleuse islamiste en train de figer les corps et les esprits. Dans son journal, Malrich crie donc à tort et à travers au camp d'extermination, distingue de futures chambres à gaz un peu partout. Mais il est hanté par ce crime des crimes et ne l'utilise pas comme une métaphore vide de sens. Alors, au lieu de s'irriter d'un tel travers, qui banalise habituellement la Shoah, le lecteur s'étonne d'un cas de figure trop rare: une conscience arabo-musulmane mue en profondeur par l'horreur hitlérienne, au lieu de dire «je passe» comme au bridge. Boualem Sansal, en sismographe des âmes, a voulu, en usant de la force tellurique du roman, placer au centre l'horreur absolue de la destruction des juifs d'Europe maintenue en périphérie. D'où les exagérations, les débordements, les maladresses, inhérents aux tremblements de terre.
Le Village de l'Allemand, sous couvert de jeunes esprits écartelés pris dans les déroutes du destin, émerge comme un récit qui traite, en pointillé, des ricochets de l'Histoire. Envers de l'Art («cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge», selon Baudelaire), la volonté de vaincre ses semblables, cette libido dominandi qui se pare de politique, se réverbère elle aussi. Le nazi Hans Schiller noyaute le FLN, qui inspirera le GIA et autres entreprises terroristes. La terre est gorgée de ce sang, dont certains hommes, certaines idéologies, certaines caricatures de religion se font passeurs assoiffés. La contamination continue, prévient Boualem Sansal, qui devine un fil rouge entre certains imams de banlieue et l'ensauvagement des talibans d'Afghanistan. Mais il est parvenu à donner aura et force à ce qui ne serait que simple slogan (l'islamisme, voilà l'ennemi!), en le plongeant dans le bain révélateur d'un roman fantasmagorique.
ANTOINE PERRAUD (LA CROIX)
Bouleversant : trois moments historiques se télescopent dans les journaux intimes rédigés par deux frères : la vie en 1996 dans une banlieue de Nantes, la guerre infligée par le GIA en Algérie quelques années avant, et plus loin dans le temps, la 2e guerre mondiale et l'enfer des camps de concentration.
Lu en avril 2017 (Emprunté à la Médiathèque de Labarthe sur Lèze)