Films, Musiques & Livres
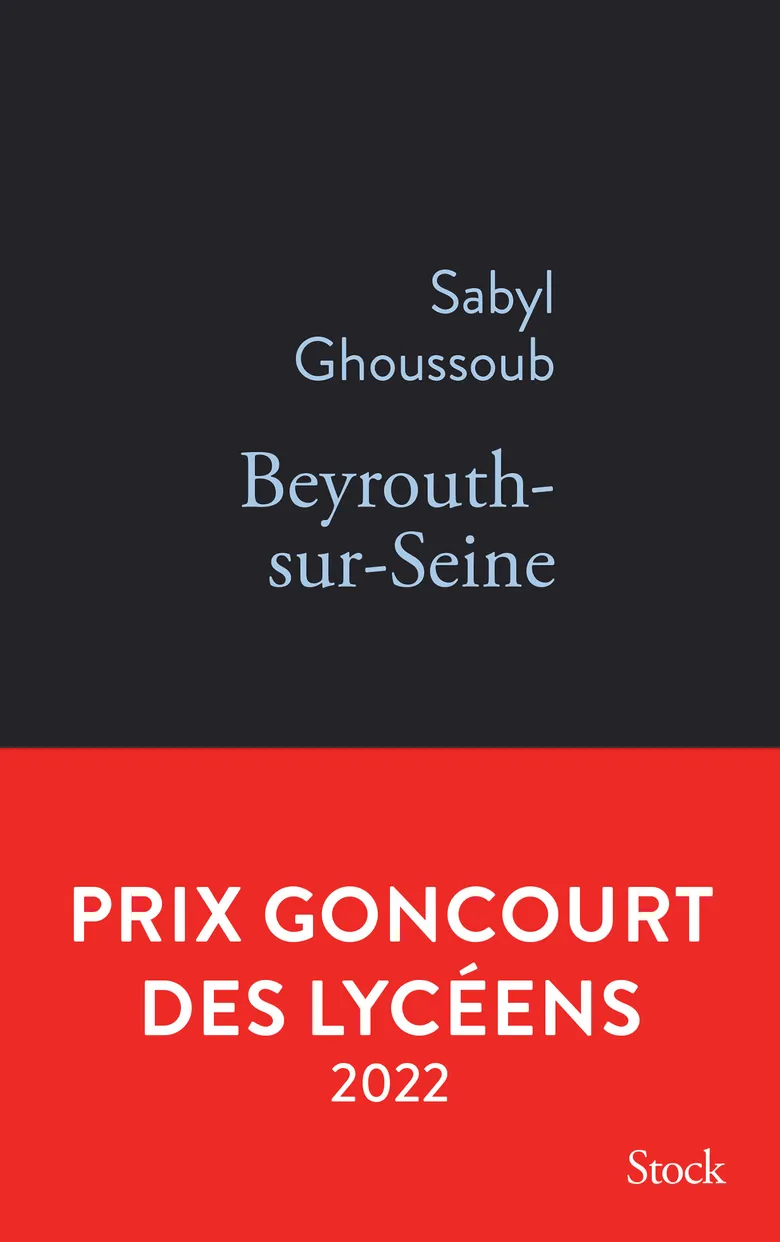
Beyrouth-sur-Seine / Sabyl Ghoussoub.- Paris : Stock, 2022
ISBN 978-2-234-09257-0
Lorsque le narrateur décide de questionner ses parents sur leur pays d’origine, le Liban, il ne sait pas très bien ce qu’il cherche. La vie de ses parents ? De son père, poète-journaliste tombé amoureux des yeux de sa femme des années auparavant ? Ou bien de la vie de son pays, ravagé par des années de guerre civile ?
Alors qu’en 1975 ses parents décident de vivre à Paris pendant deux ans, le Liban sombre dans un conflit sans fin. Comment vivre au milieu de tout cet inconnu parisien quand tous nos proches connaissent la guerre, les attentats et les voitures piégées ? Déambuler dans la capitale, préparer son doctorat, voler des livres chez Gibert Jeune semble dérisoire et pourtant ils resteront ici, écrivant frénétiquement des lettres aux frères restées là-bas, accrochés au téléphone pour avoir quelques nouvelles. Très vite pourtant la guerre pénètre le tissu parisien : des bombes sont posées, des attentats sont commis, des mots comme « Palestine », « organisation armée », « phalangistes » sont prononcés dans les JT français.
Les années passent, le conflit politique continue éternellement de s’engrener, le Liban et sa capitale deviennent pour le narrateur un ailleurs dans le quotidien, un point de ralliement rêvé familial. Alors il faut garder le lien coûte que coûte notamment à travers ces immenses groupes de discussion sur WhatsApp. Le Liban, c’est la famille désormais.
Incisif, poétique et porté par un humour plein d’émotions, Beyrouth-sur-Seine est une réflexion sur la famille, l’immigration et ce qui nous reste de nos origines.
Autour du livre, Au fil de la presse...
L’enfance échappe décidément au temps. Elle est immobile et comme prisonnière d’un présent qui n’aurait pas de commencement et pas de fin. (p105)
Je ne lis que très rarement des biographies mais, par contre, j’aime (mais je crois que je vous l’ai déjà écrit) lire des biographies d’écrivain(e)s, comment ils travaillent (ou travaillaient), comme ils sont venus à l’écriture, leurs influences, leurs lieux de vie etc…
On ne devient pas historien sans avoir une sensibilité particulière au temps. Cette impression, héritée de mon enfance, d’un temps qui ne passe pas, devait plus tard faire de moi, dans la famille bigarrée des faiseurs d’histoire, un somnambule. (p48)
Donc cette lecture quand elle m’a été proposée je l’ai acceptée même si je n’avais jamais lu d’ouvrages de Emmanuel de Waresquiel, j’étais curieuse premièrement de l’écriture à savoir est-ce qu’un biographe allait trouver le chemin de sa propre enfance et comment il allait la restituer mais aussi découvrir comment les germes de son intérêt pour l’Histoire avec un grand H (non non ce n’est pas une faute de frappe) ont émergé et sur ces deux points je crois que les réponses apparaissent dans le récit.
Une enfance bourgeoise (mais pas forcément argentée au fil des années), dans l’ouest de la France (entre Maine et Anjou), des demeures avec du personnel, un enfant unique entre un père héros de guerre discret sur ses faits et une mère dont on ressent tout l’amour qu’il lui portait mais également tout ce qu’il lui doit, ce qui la reliait à elle sans oublier l’environnement, une vie proche de la nature et des animaux et en particulier un attachement aux chiens et sur ce point je ne peux qu’adhérer….
Il faut avoir une certaine nature pour les aimer, une vraie affection pour les plus faibles, un besoin de les protéger. Il faut peut-être aussi que les humains vous aient déçu. (p30)
C’est un voyage dans le temps et les souvenirs où l’auteur picore sans toujours respecter la chronologie car il nous avertit que là n’est pas le but, mais sans pour autant nous perdre, une réminiscence faisant surgir une autre, une photo appelant une autre vision, un lieu porteur de jeux, de rencontres etc… C’est à la fois nostalgique d’un temps, le doux temps de l’enfance, mais sans regret car on ressent à quel point il a aimé son enfance et qu’il a profité de tout ce qui lui a été offert.
Entouré de livres et de traces du passé qu’elles soient écrites ou photographiées et parfois même sensorielles (la famille semble très conservatrice de documents, lettres etc…) je pense qu’il y avait là les germes de ce qui a pu développer en lui le goût des recherches, des histoires et finalement de l’Histoire avec parfois des ancêtres ayant eux-mêmes côtoyés des personnages célèbres de l’histoire mais le tout raconté avec simplicité et en ayant conscience de l’enfance privilégiée dans lequel il a évolué, l’auteur réussissant également à mettre en lumière une époque, celle de l’après deuxième guerre mondiale dans une famille marquée par le passé, les épreuves et la condition.
J’ai passé un joli moment grâce à Emmanuel de Waresquiel et même si ce ne fut que quelques bribes du passé et l’occasion de se révéler lui-même après avoir fouillé les passés des autres, si une biographie d’un personnage historique de lui passe un jour sous mes yeux (j’aime l’histoire mais il faut que l’écriture soit fluide et captivante) je serai très tentée de la lire pour voir si le charme opère à nouveau.
J’ai aimé la plume de ce sage petit garçon figurant sur la couverture, le voyage fut léger car il n’est qu’une évocation, un regard et j’ai presque regretté qu’il ne se prolonge pas un peu plus. Un bon signe…..
crédit : Blog Mumu dans le bocage
Beyrouth-sur-Seine est un le troisième roman de Sabyl Ghoussoub, journaliste et auteur, un roman à la première personne dont le projet autobiographique est explicite, puisque l’auteur y chronique l’histoire de sa famille, ou du moins d’une famille qui ressemble à la sienne, entre le Liban et la France. Le titre fait d’ailleurs référence au surnom qu’on donnait à Paris dans les années 80, lorsque la culture libanaise et arabe plus largement y était florissante.
Je suis restée très à distance de ce livre, tant à mon avis la forme lui fait défaut. Au départ, il y a donc le projet du protagoniste d’interroger ses parents sur leur passé : leur rencontre au Liban, leur mariage, puis leur arrivée à Paris dans un appartement minuscule, le mal du pays, la difficulté à trouver des épices, les liens tendus et distendus avec la famille restée là-bas, les échos des attentats et guerres successifs. Une histoire familiale éclatée racontée dans une succession de chapitres courts, selon une chronologie erratique qui fait alterner des souvenirs des parents, ceux du personnage principal, les mythologies familiales, et les événements objectifs qui ont secoué le Liban. Evidemment de ce point de vue c’est intéressant, puisque l’histoire du Liban des années soixante-dix à nos jours, est excessivement dense et complexe - les factions phalangistes et propalestiniennes qui s’affrontent, les massacres à Beyrouth, les enlèvements, le terrorisme et les assassinats politiques - mais le problème, c’est qu’on a l’impression que le livre subit cette densité plutôt qu’il ne la met en forme. Il accueille ces expériences multiples sans semble-t-il en penser grand-chose, autre que des banalités sur la “tragédie” qui secoue ce pays. Il est par exemple question à plusieurs reprises de l’engagement d’un membre de la famille :ce cousin qui aurait tué des civils, ou Elias, cet oncle si séduisant, communiste engagé dont les activités restent mystérieuses. Le récit n’en fait pas grand-chose, autre qu’un questionnement assez simpliste et peu dynamique sur la légitimité de la violence politique. On sent le narrateur, et l’auteur derrière, dans une position presque soumise par rapport à son sujet - étonnant d’ailleurs puisqu’il raconte comment il a réfléchi à la question toute sa vie, a vécu au Liban, a lui-même été témoin de la violence et de la guerre civile.
L'échec de l'autobiographique
A cette espèce d’échec documentaire s’articule une espèce d’échec du projet autobiographique. On ne sent pas, ni dans ce qui est raconté ni dans la manière dont c’est raconté, de singularité ou de spécificité du souvenir. Ce qui est raconté semble générique, propre à toute une expérience d’immigration arabe en France. Ça m’a frappée dans le portrait des parents qui sont les personnages centraux du livre : le père intello ironique qui fait des blagues sur le poids de sa femme, la mère nostalgique qui appelle tous les jours toute la famille sur WhatsApp et bourre ses enfants de houmous... On dirait un peu ces scènes clichées du cinéma français quand il s’agit de représenter la famille type méditerranéenne. J’ai pensé - et la comparaison est dure pour Sabyl Ghoussoub - à L’Arabe du futur de Riad Sattouf, autre projet biographique à cheval sur deux cultures : c’est tellement plus fin, plus profond, il y a surtout cette étrangeté propre à la mise en forme de l’intime qui est absente de Beyrouth-sur-Seine. Je ne doute pas de l'authenticité du projet, simplement la forme ne suit pas, preuve en est qu’il ne suffit pas d’un bon sujet pour faire œuvre. Au détour d’un chapitre, le héros cite le film documentaire réalisé par Martin Scorsese, Italianamerica, dont le projet est en effet similaire : Scorsese rassemble au milieu des années soixante-dix ses deux parents sur le canapé familial, et les interroge sur leur jeunesse dans le New-York fourmillant de migrants plus ou moins fraîchement débarqués. Mais là aussi la comparaison est cruelle, car dans le film de Scorsese, il y a de la mise en scène et un point de vue, celui du réalisateur, qui ne ménage pas ses parents, les bouscule, se moque. Un point de vue, voilà ce qu’il manque à ce Goncourt des lycéens, qui a certainement tenté de faire œuvre de pédagogie au risque de la platitude.
Crédit : Lucile Commeaux, Le masque et la plume, France inter
___________________________________________________________________
Je ne lis que très rarement des biographies, surtout contemporaines ! Si j’en lis une, en général, la personne n’est plus de ce monde… Enfin, vous comprenez mon idée, je pense. Pourtant , Beyrouth-sur-Seine m’a tout de suite donné envie de plonger dans la vie de Sabyl Ghoussoub, enfin surtout celle de ses parents !
Et puis franchement, ce titre est tellement bien trouvé, évocateur, que je ne pouvais pas passer à côté.
Sabyl Ghoussoub donne la parole à ses parents, à ces hommes et ces femmes, tiraillés entre deux pays. L’exil au péril de sa vie. Un pied en France, un pied dans leur pays. Comment se sentir épanoui, heureux, lorsque la moitié de son cœur est ailleurs.
L’auteur, nous fait découvrir à la fois ses parents, leur humilité, leurs peurs, mais aussi tout un pan historique que ce soit du Liban ou de la France sur plusieurs décennies. On apprend, beaucoup de choses sur la politique qu’elle soit libanaise, ou française et j’ai trouvé ça excellent !
J’ai retrouvé quelques parallèles entre ce que j’ai pu vivre, ressentir mais aussi ce qui a parsemé ces années où la guerre au Liban touchait tout Paris. Le monde intellectuel était largement influencé par la culture libanaise avec une sensation de fusion entre le Liban et Paris.
L’auteur décortique les évènements libanais, et leur influence sur la capitale française tout en analysant les réactions, les peurs de ses parents, mais aussi, chose complètement folle, il met en exergue les attentats qui ont eu lieu à Paris, et les combats qui ont lieu au Liban. Les scènes de combats versus les images sanglantes des rues de Paris. C’est franchement fou et diablement bien construit, on est saisie d’effroi et en même temps c’est une illumination.
Un texte court, dense, triste et beau à la fois. Un hymne à ses parents, un livre plein d’amour, tout en retenu, car l’auteur n’omet rien. Il y parle de ses oncles, impliqués dans la politique libanaise, pas forcément dans le même camp qui font l’Histoire de son pays.
A travers ce récit, il raconte l’exil mais aussi le deuil d’un pays déchiré par la guerre et les luttes fratricides.
C’est un histoire d’une rare finesse, tout en profondeur, qui évoque à la fois des sujets politiques, géopolitiques, qui malgré leurs complexités, sont rendus accessibles par les descriptions et la vulgarisation que l’auteur apporte. Un livre nécessaire sur l’identité, l’exil, l’appartenance, l’enracinement.
« Mes références viennent d’ailleurs et beaucoup du monde arabe, pourtant j’ai grandi en France. J’ai alors l’impression bancale d’avoir grandi ailleurs tout en ayant grandi ici. »
A lire si vous voulez tenter de comprendre le déracinement. Si j’osais, je dirais que ce livre devrait faire partie des œuvres obligatoires du cursus scolaire au lycée.
Crédit : Ju lit les mots (blog)
------------------------------------------------------
Premières phrases du livre :
" Je veux vieillir et mourir au Liban
Et nager tous les jous
Jusqu'à l'infini "
Ma mère
" Peut- être qu'au cimetière du Père-Lachaise,
Je me sentirai enfin chez moi "
Mon père
Mon père, ma mère, Paris, 2000
“ Tu veux que je te raconte ma vie en arbe ou en français ? ” m'a demandé mon père et il a aajouté “ Tu comprends l'arabe ? ” alors qu'il a été mon professeur d'arabe pendant trois longues annéesoù je vivais chacune de ses leçons comme un calvaire sans fin.
Je venais de brancher un micro sur sa chemise de pyjama qu'il traine depuis mes cing ans. Elle a été cousue et recousue par des couturiers kurdes, irakiens, coréens, et certains d'entre eux ont même mis des patchs en jean dessus pour combler les trous. Ma mère a eu beau lui acheter plus d'une dizaine de nouveaux ensembles , il n'a jamais porté que celui-là, qu'il a acheté au Liban. Un pyjama bleu marine composé d'une chemise et d'un pantalon trop court. "
L'auteur nous plonge dans une famille libanaise émigrée à Paris dans les années 1980. Alternant scènes à Paris et bouffées de souvenirs de quelques retours au Liban, il s'attache à décrire avec beaucoup d'humilité et de désepérance les différents groupes humains en conflit sur ce territoire (Druzes, Chiites, Palestiniens, Phalangistes, Communistes)… mais on reste sur sa fin : les précisions historiques sont livrées ‘à la volée’, on est un peu perdu tandis que l'auteur suit le fil de sa mémoire, convoque des souvenirs au gré des conversations qu'il partage avec ses parents (peu loquaces en réponse aux nombreuses questions posées par leur fils).
(Lu en mai 2025, collection Médiathèque de Labarthe-sur-Lèze)