Films, Musiques & Livres
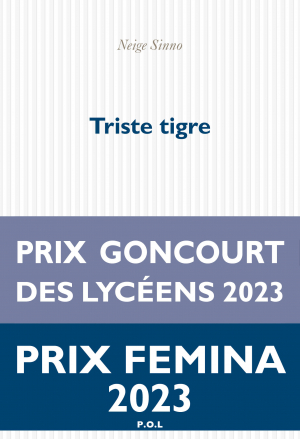
Triste tigre / Neige Sinno.- Paris : POL, 2023
ISBN 978-2-234-09257-0
« Il disait qu’il m’aimait. Il disait que c’est pour pouvoir exprimer cet amour qu’il me faisait ce qu’il me faisait, il disait que son souhait le plus cher était que je l’aime en retour. Il disait que s’il avait commencé à s’approcher de moi de cette manière, à me toucher, me caresser c’est parce qu’il avait besoin d’un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l’aimais. Ensuite, il me punissait de mon indifférence à son égard par des actes sexuels. »
Entre 7 et 14 ans, la petite Neige est violée régulièrement par son beau-père. La famille recomposée vit dans les Alpes, dans les années 90, et mène une vie de bohème un peu marginale. En 2000, Neige et sa mère portent plainte et l’homme est condamné, au terme d’un procès, à neuf ans de réclusion. Des années plus tard, Neige Sinno livre un récit déchirant sur ce qui lui est arrivé. Sans pathos, sans plainte. Elle tente de dégoupiller littéralement ce qu’elle appelle sa « petite bombe ». Il ne s’agit pas seulement de l’histoire glaçante que le texte raconte, son histoire, une enfant soumise à des viols systématiques par un adulte qui aurait dû la protéger. Il s’agit aussi de la manière dont fonctionne ce texte, qui nous entraîne dans une réflexion sensible, intelligente, et d’une sincérité tranchante. Ce livre est un récit confession qui porte autant sur les faits et leur impossible explication que sur la possibilité de les dire, de les entendre. C’est une exploration autant sur le pouvoir que sur l’impuissance de la littérature. Pour se raconter, la narratrice doit interroger d’autres textes, d’autres histoires. Elle nous entraîne dans une relecture radicale de Lolita de Nabokov, ou de Virginia Woolf, et de nombreux autres textes sur l’inceste et le viol (Toni Morrison, Christine Angot, Virginie Despentes). Comment raconter le « monstre », « ce qui se passe dans la tête du bourreau », ne pas se contenter du point de vue de la victime ? Jusqu’à reprendre la question que le poète William Blake adressait au Tigre : « Comment Celui qui créa l’Agneau a-t-il pu te créer ? » (The Tyger). Le récit de Neige Sinno nous fait alors entrer dans la communauté de celles et ceux qui ont connu « l’autre lieu », celui de la nuit et du mal, qui ont pu s’en extraire mais qui en sont à jamais marqués, et se tiennent ainsi à la frontière des ténèbres et du jour. Nulle résilience. Aucun oubli ni pardon. Juste tenter de tenir debout, écrire son récit comme une « petite bombe artisanale qu’on fait exploser tout seul chez soi, dans l’intimité de la lecture. Elle a l’intensité et la fragilité des choses conçues dans la solitude et la colère. Elle en a aussi la folle et ridicule ambition, qui est de faire voler ce monde en éclats. »
Autour du livre, Au fil de la presse...
"Triste Tigre" : le tour de force littéraire de Neige Sinno pour panser l'indicible
Le livre figure sur presque toutes les listes des Prix d'automne. C'est le récit des abus que l'auteure a subis durant son enfance, en même temps qu'une réflexion sur le pouvoir et l'impuissance de la littérature. Un langage d'une très grande intelligence salué à l'unanimité par Le Masque.
La première phrase de cet ouvrage : "Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau". Le bourreau, c'est le beau-père de Neige Sinno, qui l'a violée régulièrement quand elle avait entre sept ans et quatorze ans. En 2000, Neige et sa mère ont porté plainte et l'homme a été condamné à neuf ans de réclusion. Elle cite notamment "Lolita" de Vladimir Nabokov, les textes de Toni Morrison, Christine Angot, Virginie Despentes. Un livre qui connaît un grand succès malgré les préventions exprimées par l'auteure, puisque le succès, écrit-elle, "ce serait une façon d'exister dans la littérature, non pas par mon écriture, mais par mon sujet, ce qui a toujours été ma hantise, exister à mon tour par le biais de quelque chose que je n'ai pas fait, mais qu'on m'a fait. Quel cauchemar !".
Nelly Kapriélan salue une très grande force de réfléxion
Pour la critique des Inrockuptibles, c'est la grande surprise littéraire de la rentrée : "C'est une grande découverte sur un sujet malheureusement trop souvent traité par les écrivains. C'est comme si c'était Christine Angot et Maggie Nelson qui s'étaient rencontrées. En racontant ce qui s'est passé, elle s'interroge constamment. Elle écrit des phrases fulgurantes, qui traduisent une réflexion sur l'impuissance ou la puissance de la littérature. Elle se demande si le témoignage ne doit pas être aussi considéré comme un acte littéraire. C'est aussi une réflexion sur le mal produit, sur comment un être humain peut faire autant de mal et aussi longtemps à un autre être humain. Elle inscrit toujours son écriture dans une tension qui se rapporte au cœur de la psyché des victimes. Elle rassemble tous les outils pour essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas compréhensible".
Olivia de Lamberterie applaudit un tour de force littéraire
Pour la journaliste du magazine Vogue, l'auteure opère une magnifique combinaison entre la littérature et un témoignage aussi éprouvant pour la victime qui raconte ce qui lui est arrivé de terrible. Un récit qui se pense comme un remède exceptionnel à la cruauté : "Son projet est de nous faire pénétrer dans une sorte de dimension obscure, inconnue, où il a été possible que son beau-père la viole entre sept et quatorze ans. C'est vraiment un livre, non pas sur ce qui lui est arrivé, mais sur la possibilité de le raconter.
Elle explique au passage que la littérature ne l'a absolument pas sauvée. Loin d'être une thérapie, au contraire, elle met à mal tous les clichés suivant lesquels on dépose son fardeau par la plume. Elle pose même la question pour le lecteur et vis-à-vis de son violeur, sur est-ce que ce n'est pas lui faire trop d'honneur finalement.
Il y a quelque chose de formidable autour, dans l'accueil critique et public de ce livre qui démontre qu'il se passe bien quelque chose".
Elisabeth Philippe très sensible à la quête ambivalente qui habite cette écriture
Chez L'Obs, Elisabeth Philippe considère que c'est un livre qui apparaît comme un geste existentiel total, qui passe par la littérature. Si elle reconnaît une force incontestable du propos, littérairement, il reste difficile de cerner, selon elle, un texte qui a pour seule structure le flux de sa propre pensée (de l'auteure) : "Elle essaie d'aborder une terrible question qu'elle-même ne comprend pas au départ, elle ne comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête de ce bourreau. Ce livre est un cheminement, une quête vers la vérité. Elle va utiliser tous les outils qui sont à sa disposition pour essayer d'éclairer cet obscur. Elle s'appuie vraiment sur toutes les ressources possibles, la littérature, les coupures de presse, les comptes-rendus du tribunal, des photos, elle n'élude aucune question, y compris celle du désir. Toutes les facettes de la question sont envisagées.
Mais ma réception reste ambivalente comme l'auteure elle-même fait part de cette ambivalence par rapport à l'écriture. Déjà, elle exprime sa relative réticence à écrire ce livre et elle dit qu'elle ne veut pas faire de témoignage en écrivant sur l'inceste. Elle non plus ne veut pas tomber dans le témoignage et dit aussi que l'idée de faire de l'art à partir de ce qui lui est arrivé la dégoûte".
Arnaud Viviant salue une très grande réflexion post-moderne qur l'inceste
La grande force du livre réside, selon Arnaud Viviant, précisément dans cette forme fragmentaire naturelle de l'auteure : "C'est ce qui évite tout discours totalisant sur le sujet et qui évite de se placer dans un registre immédiatement littéraire. J'ai pensé à Roland Barthes, car il y a un côté discours du fragment incestueux qui serait l'envers du discours d'un fragment amoureux. Elle construit son livre avec des éléments hétéroclites, et ce qui est assez fort, même si le mot est écrit une seule fois, c'est qu'il n'y a pas de haine dans ce livre. Il y a vraiment une réflexion et un vouloir comment écrire l'inceste après Christine Angot, après Nabokov, après Virginia Woolf, après Toni Morrison. C'est comment s'inscrire dans un discours sur l'inceste qui soit postmoderne, après un corpus originel existant".
Crédit : Le masque et la plume, France inter
------------------------------------------------------
Premières phrases du livre :
Chapitre 1.
Prtraits
Portrait de mon violeur
Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile on peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est, ou on croit qu'on peut imaginer.
Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul avec un enfant de sept ans […]
Récit à la première personne très dérangeant. L'auteur a été abusée par son beau-père pendant des années. On se sent impuissant, affligé par le degré de violence infligé à l'enfant qu'elle était. J'ai beaucoup hésité avant de me planger dans ce texte, mais je regrette d'avoir franchi le pas. La grande lucidité dont elle fait preuve : son traumatisme ne disparaitra probablement jamais, et la parole, la souffrance exprimée sans distenciation laissent le lecteur démuni face à l'auteur qui oscille entre le portrait de son agresseur, qui quoi qu'elle en dise semble la hanter et rélexions plus génrérales sur l'inceste. J'avais éprouvé un malaise assez proche lorsque j'ai lu ‘L’adversaire' d'Emmanuel Carrère.
Pourtant l'ouvrage s'ouvre sur une analyse très fine du roman ‘Lolita' de Vladimir Nabokov, en ce qu'elle relève la méprise de bien des lecteurs qui l'ont lu comme une apologie de la pédocriminalité, considérant Lolita comme une égérie érotique, au grand dam de l'auteur.
(Lu en mai 2025, collection Médiathèque de Labarthe-sur-Lèze)