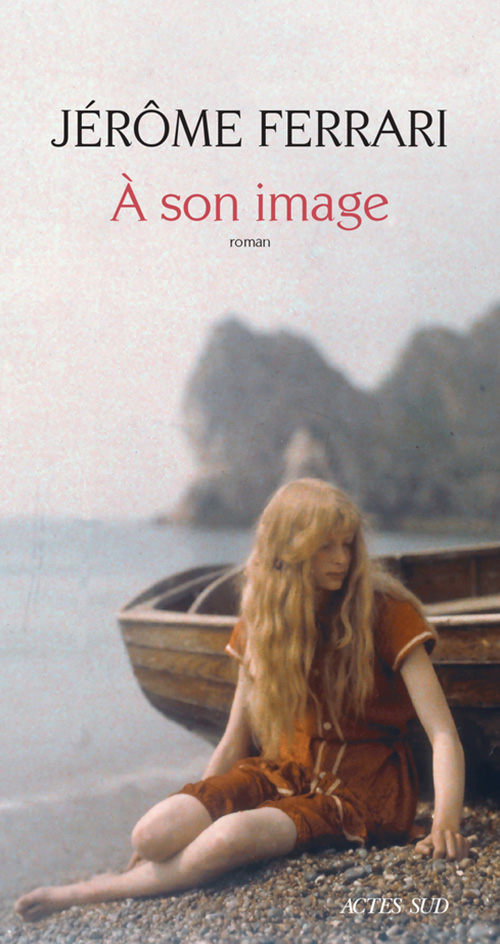Films, Musiques & Livres
Par une soirée d’août, Antonia, flânant sur le port de Calvi après un samedi passé à immortaliser les festivités d’un mariage sous l’objectif de son appareil photo, croise un groupe de légionnaires parmi lesquels elle reconnaît Dragan, jadis rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Après des heures d’ardente conversation, la jeune femme, bien qu’épuisée, décide de rejoindre le sud de l’île, où elle réside. Une embardée précipite sa voiture dans un ravin : elle est tuée sur le coup.
L’office funèbre de la défunte sera célébré par un prêtre qui n’est autre que son oncle et parrain, lequel, pour faire rempart à son infinie tristesse, s’est promis de s’en tenir strictement aux règles édictées par la liturgie. Mais, dans la fournaise de la petite église, les images déferlent de toutes les mémoires, reconstituant la trajectoire de l’adolescente qui s’est rêvée en photographe, de la jeune fille qui, au milieu des années 1980, s’est jetée dans les bras d’un trop séduisant militant nationaliste avant de se résoudre à travailler pour un quotidien local où le “reportage photographique” ne semblait obéir à d’autres fins que celles de perpétuer une collectivité insulaire mise à mal par les luttes sanglantes entre clans nationalistes.
C’est lasse de cette vie qu’Antonia, succombant à la tentation de s’inventer une vocation, décide, en 1991, de partir pour l’ex-Yougoslavie, attirée, comme tant d’autres avant elle, dans le champ magnétique de la guerre, cet irreprésentable.
De l’échec de l’individu à l’examen douloureux des apories de toute représentation, Jérôme Ferrari explore, avec ce roman bouleversant d’humanité, les liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le réel et la mort.« DANS LES ANNÉES 1990, j’ai découvert la photo de Ron Haviv sur laquelle un paramilitaire des tigres d’Arkan prend son élan pour frapper les cadavres de trois civils qu’il vient d’abattre, quelque part en Bosnie. Il porte des lunettes de soleil à monture blanche et, entre les doigts de sa main gauche, il tient une cigarette dans un geste d’une absolue désinvolture. Ce garçon était manifestement mon contemporain, il était à peine plus âgé que moi et notre évidente proximité avait quelque chose d’intolérable. La guerre sortait des livres d’histoire.
C’est alors, je crois, que j’ai pour la première fois fait l’expérience de la puissance des photographies et de la façon dont elles bouleversent notre rapport au temps : ce qu’elles nous montrent est à chaque fois figé pour toujours dans la permanence du présent et a pourtant, dès le déclenchement de l’obturateur, déjà disparu. Personne n’a énoncé ce paradoxe plus clairement que Mathieu Riboulet : « La mort est passée. La photo arrive après qui, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps mais le fixe. »
Parce que la mort est passée, le roman s’ouvre sur celle d’Antonia et passe par toutes les étapes de la messe de ses funérailles. Au cours d’une vie consacrée aux photographies, les plus insoutenables et les plus futiles, des portraits de famille, des conférences de presse clandestines, des attentats, des mariages, la guerre en Yougoslavie, elle s’est constamment sentie renvoyée de l’insignifiance à l’obscénité.
Le roman est donc l’histoire de son échec. Le prêtre qui célèbre la messe est l’oncle d’Antonia. C’est aussi lui qui l’a portée sur les fonts baptismaux et qui lui a offert, pour son quatorzième anniversaire, son premier appareil photo. J’imagine qu’il ne se le pardonne pas. »
J. F.
présentation de l'éditeur
Extraits choisis...
Dragan D., jeune Serbe mobilisé en 1992 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, qui vient de vire des mois d'horreur, rentre chez lui :
" Début novembre, Antonia V. revient à l'hôtel Moskwa qui s'est vidé de ses journalistes. Les choses tournent mal, trop vite, de tous les côtés à la fois, tout est trop difficile à suivre, et ils sont tous partis e Bosnie. Quand elle retrouve Dragan D. , il a beaucoup maigri. il lui sourit faiblement. Elle se demande ce qu'il a vu. Elle se demande ce qu'il a fait.
Le jour de sa démobilisation, elle le suit dans l'accomplissement de ses démarches administratives qui le libèrent et le rendent à la vie passée qu'il ne retrouvera pourtant jamais. Il es prévu qu'on le ramène à Belgrade en bus militaire. De là, il rentrera chez lui par les lignes régulières. Il demande au chauffeur s'il accepte la présence d'Antonia V. Le chauffeur grommelle quelque chose.
Il n'en a rien à foutre, traduit Dragan D.
Mais elle avait compris.
Le bus est presque vide. En plus d'Antonia V. et Dragan D., il n'y a que quatre passagers, trois soldats et un paramilitaire qui traîne un paire de valises pleines à craquer. Le bus roule dans la plaine. A un checkpoint, il sont contrôlés par la police militaire qui leur demande de descendre et d'ouvrir leurs bagages.
Le paramilitaire prend l'un des policiers par le bras et l'entraîne à l'écart. il lui parle un moment en lui tapant sur l'épaule. Le policier approuve vigoureusement. Le paramilitaire prend quelque chose dans l'une de ses valises et le donne au policier qui lui serre la main et lui fait signe de reprendre sa place dans le bus.
Les policiers se tournent maintenant vers Dragan D. Ils fouillent son sac militaire d'où ils sortent des cassettes audio et deux livres qu'ils lui agitent sous le nez avant de les lancer par terre. Ils rient. Antonia V. sait qu'elle devrait prendre des photosmais, une fois encore, elle n'ose pas. Elle pense à ROn H. Elle se saisit de son appareil aussi discrètement que possible. Elle prend les photos.
Elle remonte dans le bus et s'assoit près de Dragan D. Il tremble comme s'il avait la fièvre. Il lui prend le poignet. Des salauds, dit-il, des connards de Belgrade. Regarde-moi, regarde dans quel état je suis, regarde le treillis dégueulasse que je porte. Je reviens du front, putain. ILs devraient me donner une médaille. Mais eux, ils s'en foutent, avec leurs saloperies d'uniformes tous propres, ils me traitent comme une merde. Parce que moi je n'ai rien à leur donner et que ça les énervent. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec mes livres ? Voilà ce qui dirige le pays maintenant. Des supporters de foot et des débiles qui jettent les livres. Pourquoi tu lis un con de Hongrois ? Ils m'ont demandé. Pourquoi tu lid un con de Polonais ? Pour ces types, Bukowski, c'est un con de Polonais. Les salauds. Les salauds.
Lu en juin 2019 (collection Médiathèque de Venerque, Marianne)